HET : William Petty
Sir William Petty, 1623-1687.
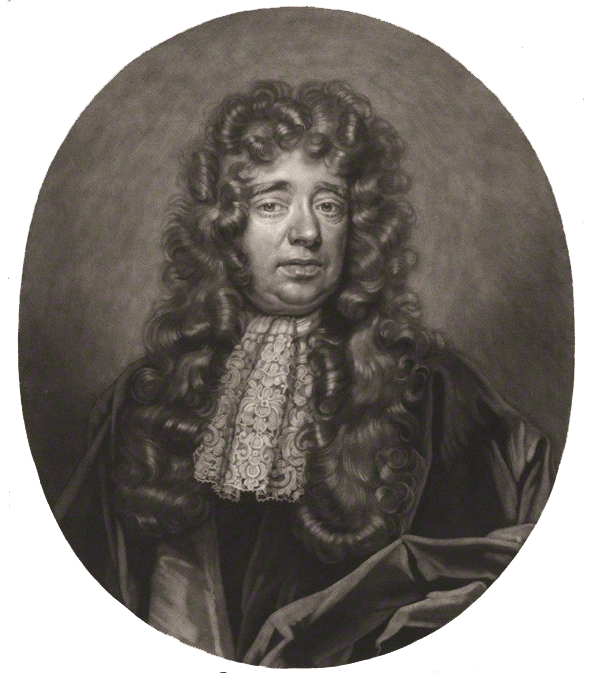

Mercantiliste anglais, fondateur de « l’arithmétique politique »
William Petty, « l’homme le plus rationnel d’Angleterre », comme l’appelait Samuel Pepys, ou un « aventurier frivole, cupide et sans principes » comme le préférait Karl Marx (1859), est né fils d’un drapier à Romsey, dans le Hampshire. L’éducation de Petty a été plutôt irrégulière jusqu’à ce qu’il s’enfuie de chez lui et prenne un emploi de garçon de cabine sur un navire marchand à l’âge de 13 ans. L’année suivante, Petty se casse la jambe à bord du navire et, comme le veut la coutume de l’époque, il est abandonné sur la côte normande. Le garçon blessé est recueilli par des religieux jésuites français qui, impressionnés par son intelligence, l’admettent dans leur collège de Caen, payant eux-mêmes son entretien. La majeure partie de l’éducation de Petty, notamment en mathématiques, y fut acquise.
William Petty finit par retourner en Angleterre où, après avoir travaillé pendant une courte période à la rédaction de cartes marines, il s’engagea pour une période dans la Royal Navy en 1640. En 1643, alors que la guerre civile entre le roi et le Parlement fait rage, Petty rejoint la vague de réfugiés anglais aux Pays-Bas, puis en France. C’est probablement la période la plus enchanteresse de la vie de Petty. Il s’est lancé dans diverses entreprises, travaillant pour un opticien à Amsterdam, étudiant l’anatomie à Leyden et fréquentant d’autres sommités en exil. Le plus remarquable est le séjour de Petty à Paris en tant que secrétaire privé de Thomas Hobbes, grâce auquel il est introduit dans le milieu intellectuel bouillonnant de la capitale française, notamment dans le cercle de l’abbé Mersenne. C’est au cours de ce séjour que Petty absorbe les nouvelles de la méthode scientifique et de l’empirisme, qu’il ne tardera pas à transposer lui-même en économie.
En 1646, Petty retourne en Angleterre pour mettre de l’ordre dans les affaires de son défunt père. Après une tentative ratée de vendre son invention d’un instrument à double écriture, Petty gravite à Oxford et poursuit ses études de médecine. Sa réanimation du cadavre d’une jeune femme pendue pour meurtre fait de lui une sorte de célébrité locale. En 1650, Petty était devenu docteur en médecine, professeur d’anatomie, fellow et vice-chancelier du Brasenose College, à Oxford. À ce portefeuille, il ajoute bientôt (avec l’aide de son ami mercier John Graunt) la chaire de musique du Gresham College de Londres (fondé par Thomas Gresham en 1597). C’est à Gresham que Petty est tombé dans un groupe de discussion de jeunes nouveaux scientifiques, notamment John Wilkins, Robert Boyle, Christopher Wren, John Wallis, Robert Hooke, et autres, qui se sont appelés en plaisantant le « Collège invisible ».
En 1652, Petty prend congé d’Oxford et voyage comme médecin général dans l’armée de Cromwell en Irlande. L’acte punitif de colonisation de 1652 confisquait les terres de tous les combattants irlandais et déplaçait une grande partie de la population restante vers la province de Connaught, laissant la majeure partie de l’Irlande ouverte à la colonisation anglaise. Cromwell avait l’intention d’utiliser les terres irlandaises pour récompenser les vétérans de l’armée parlementaire en lieu et place de salaires en espèces, mais aussi pour régler les créanciers parlementaires et récolter des fonds en les vendant à une grande variété d' »aventuriers » colons anglo-écossais.
À cette fin, une enquête exhaustive sur les valeurs des domaines confisqués était nécessaire. Une enquête était déjà en cours, dirigée par l’arpenteur général Benjamin Worsley. Mais en utilisant les moyens lents et minutieux, l’enquête de Worsley prendrait probablement 13 ans pour être achevée. Petty, s’appuyant sur son expérience pratique de la cartographie nautique, critiquait ouvertement les méthodes de Worsley et proposait de le faire mieux et plus rapidement. Finalement, en décembre 1654, après suffisamment de manœuvres politiques, le jeune médecin obtient le contrat pour arpenter lui-même les terres de l’armée. Faisant appel à des milliers de soldats sans emploi, plutôt qu’à une poignée d’arpenteurs qualifiés, et confiant les résultats à une équipe centrale de cartographes réunie à Dublin, Petty a terminé l’arpentage de la moitié de l’Irlande – le fameux « Down Survey » – en 13 mois, un temps étonnamment rapide. Le Down Survey de Petty devait continuer à servir de référence légale pour les litiges fonciers en Irlande pendant une bonne partie du 19e siècle.
Petty s’est fait une fortune dans le processus. Le fils du pauvre drapier finira par posséder de vastes terres à travers l’Irlande – selon Aubrey, quelque 50 000 acres, dont une grande partie autour de Kenmare, dans le comté de Kerry, rapportant un revenu annuel de 7 000 à 8 000 livres. Cette richesse princière, il l’a en partie gagnée en récompense de ses efforts dans la composition de l’enquête. Le reste, il l’a acquis en faisant partie de la commission chargée de répartir les parcelles de terre entre les anciens combattants. Ce perchoir lui ouvre de grandes possibilités d’enrichissement personnel pour lui-même et ses amis. Petty a scellé de nombreux accords personnels avec des soldats qui préféraient se faire racheter plutôt que d’attendre de prendre possession de leurs terres (et qui connaissait mieux que Petty lui-même la valeur réelle de ces parcelles de terre ?).
Petty a fait l’objet d’accusations vicieuses de corruption, de fraude et de malfaisance dans le règlement des terres de l’armée irlandaise. Une bonne partie était sans doute vraie. Mais une grande partie était également motivée par la rivalité politique entre Henry Cromwell (le fils du Lord Protecteur et le proche compagnon de Petty) et l’ambitieux Lord Deputy d’Irlande, Charles Fleetwood (dont la base se trouvait dans le camp républicain plus radical de l’armée). Petty était donc un paratonnerre naturel pour les critiques d’un parti militaire soupçonnant les prétentions à l’agrandissement du clan cromwellien.
Les accusations atteignent un crescendo en 1658, après la mort du puissant Oliver Cromwell. L’ascension controversée de son fils Richard Cromwell réanime le républicanisme endormi de l’armée. Lorsque Petty était en mission à Londres, les officiers de l’armée en Irlande ont forcé Henry Cromwell, affaibli, à ouvrir à contrecœur une enquête sur les affaires de Petty. Mais Petty persuade Cromwell de remplir la commission avec ses amis, et les officiers de l’armée ne parviennent pas à obtenir une condamnation. Entre-temps, Petty s’était présenté avec succès au Parlement pour le siège de West Looe et était rentré en Angleterre. Mais son entrée au Parlement est accueillie par un renouvellement des accusations, cette fois portées par un prédicateur de l’armée, Sir Jerome Sanchey, sur le parquet de la Chambre des Communes. Mais avant que cette question ne soit résolue, le Parlement est dissous dans le chaos politique qui enveloppe rapidement l’Angleterre. Pour blanchir son nom, Petty se sentit obligé de mettre les détails de cette controverse devant le public par écrit (1659, 1660).
En 1660, la révolte de l’armée s’effondre et le Commonwealth cède la place à la restauration de la monarchie Stuart sous Charles II. Henry Cromwell et Petty, qui étaient depuis longtemps en désaccord avec l’armée, rendirent tous deux des services essentiels aux royalistes en ces jours grisants. Le nouveau roi Charles II, reconnaissant, permit à Cromwell de se retirer avec élégance et à Petty d’entrer à sa cour. Petty gagna rapidement la confiance du roi Stuart, qui accorda un titre de chevalier au fils du drapier en 1661. Des pairies lui ont également été offertes, mais Petty les a refusées, les considérant comme des tentatives de se débarrasser de ses pétitions pour obtenir un véritable poste gouvernemental avec une influence politique – « plus tôt être un farthing de cuivre de valeur intrinsèque qu’une demi-couronne de laiton, quelle que soit la manière dont elle est estampillée ou dorée », a-t-il marmonné.
Les idées – politiques et autres – étaient quelque chose dont Petty débordait à cette époque. Partageant son temps entre Oxford et Londres, Petty a repris sa participation au « Collège invisible » de Boyle, Wren, Wilkins et al. qui, en 1662, avait l’approbation du roi et une charte royale d’incorporation en tant que « Société royale de Londres pour l’amélioration des connaissances naturelles ». L’une des entreprises les plus intéressantes de Petty à cette époque était l’invention d’un navire à double fond, dont il a donné un prototype au roi Charles II (finalement perdu en mer), et dont un modèle a été donné à la Royal Society.
C’est à cette époque que Petty publie son premier traité économique, le Treatise on Taxes and Contributions (1662) (initialement publié anonymement mais dont la paternité a finalement été confirmée publiquement en 1685). Conçu comme un manuel de politique visant à augmenter les revenus royaux, il était rempli de propositions de réforme fiscale, de politique commerciale et (quelque chose qui lui tenait à cœur) de l’organisation d’un organisme statistique royal que, naturellement, Petty espérait diriger lui-même.
La grande innovation de cet ouvrage est l’articulation par Petty (certains disent la première découverte) du concept de « surplus » économique et de la théorie de la valeur du travail. Petty a trouvé cette idée en s’attaquant à la « nature mystérieuse » des rentes foncières. Un siècle avant les physiocrates, Petty a évité de caractériser le loyer comme un coût, mais l’a plutôt vu comme une déduction de l’excédent ou du produit net (qu’il appelle simplement « loyer ») de la production après avoir déduit les besoins pour soutenir le travail et le capital pour la production de l’année suivante. (« Je dis que lorsque cet homme a prélevé sa semence sur le produit de sa récolte, ainsi que ce qu’il a mangé et donné à d’autres en échange de vêtements et d’autres produits de première nécessité, le reste du maïs est le loyer naturel et véritable de la terre pour cette année » (Petty, 1662). C’est ainsi que Petty met en place le premier modèle de reproduction classique.
Petty avance à tâtons vers une théorie de la valeur en posant l’équivalence du temps de travail et de l’effort pour produire ce surplus agricole avec la quantité d’argent (excédentaire) (c’est-à-dire l’argent) qui peut être produite avec le même temps de travail et le même effort. (« combien vaut l’argent anglais ce maïs ou ce loyer ? Je réponds, autant que l’argent qu’un autre homme seul peut économiser, dans le même temps, en plus de sa dépense, s’il s’employait entièrement à le produire et à le fabriquer » (1662 : p.43)). Ainsi, si le temps de travail pour produire un shilling d’argent est égal au temps de travail pour produire un boisseau de maïs, alors la valeur d’un boisseau est un shilling, et la valeur d’un shilling est un boisseau, » l’un est le prix naturel de l’autre » (Petty, 1662 : p.50).
En bref, les valeurs relatives sont déterminées par le temps de travail relatif dépensé pour leur production. Petty reconnaît que cette valeur du travail n’est pas exacte, que les prix réels du marché peuvent s’en écarter incidemment : « Je dis que c’est le fondement de l’égalisation et de l’équilibrage des valeurs ; pourtant, dans les superstructures et les pratiques qui en découlent, je confesse qu’il y a beaucoup de variété, et d’intrication » (p.44).
Petty va assez loin pour expliquer la simple dynamique gravitationnelle : si les valeurs marchandes ne sont pas égales aux valeurs en temps de travail, alors le producteur de la marchandise sous-évaluée perd du temps de travail par l’échange, et trouvera avantage à concentrer son travail sur la production du bien surévalué. Les changements relatifs de l’offre qui en résultent feront monter le prix du premier et baisser le prix du second jusqu’à ce que les valeurs du marché égalent à nouveau les valeurs intrinsèques du temps de travail.
Petty s’écarte des autres auteurs de l’époque mercantiliste en considérant la richesse d’une nation comme les ressources réelles du pays, plutôt que dans l’or et l’argent accumulés. Mais, comme les autres mercantilistes, il se préoccupe du pouvoir de l’État monarchique et, par conséquent, de l’imposition efficace de la richesse réelle. Dans son Verbum Sapienti (écrit vers 1664/5 mais laissé inédit jusqu’en 1691), Petty fait sa première tentative d’estimation de la richesse et des revenus réels de l’Angleterre, dans le prolongement de sa préoccupation pour la base imposable.
Petty mesure le revenu national par la méthode des dépenses – qu’il obtient en calculant le montant dépensé par personne et en le multipliant par le nombre estimé de personnes. Petty estime que la population est d’environ 6 millions de personnes, et comme la personne moyenne dépense 4,5d par jour pour « la nourriture, le logement, les vêtements et tous les autres produits nécessaires » (Petty, 1665 ), les dépenses totales s’élèvent à 40 millions de livres par an. Du côté des revenus, il calcule que le rendement des terres s’élève à 8 millions de livres sterling et celui des autres domaines à 7 millions de livres sterling, ce qui implique (de manière résiduelle) que le revenu du travail doit s’élever à 25 millions de livres sterling si l’on veut égaliser les revenus et les dépenses (p.108). Outre l’absence insatisfaisante de statistiques indépendantes sur le revenu du travail, il ne lui est pas venu à l’esprit qu’il ne mesurait que les dépenses de consommation et qu’il avait négligé l’importante catégorie des dépenses d’investissement en capital Cela sera corrigé plus tard par ses disciples Gregory King et Charles Davenant.
S’intéressant ensuite aux stocks, Petty tente de mesurer non seulement la richesse matérielle de la nation, mais aussi sa « population-richesse », c’est-à-dire la valeur monétaire de la population elle-même (ce qui peut être interprété comme la valeur monétaire de la capacité productive de la population). Selon les calculs de Petty, la richesse matérielle de l’Angleterre s’élève à environ 250 millions de livres sterling et la « richesse de la population » à 417 millions de livres sterling supplémentaires (soit 69 livres sterling par tête). Il obtient ce dernier chiffre en raisonnant proportionnellement sur le revenu par richesse et le calcul résiduel du revenu du travail (c’est-à-dire que Petty stipule £15/£250 = £25/(richesse de la population), il en déduit donc la richesse de la population = £417).
De là, Petty conclut que le travail (« les gens considérés sans aucune succession du tout », p.110) est sous-imposé, et que la charge fiscale entre les successions et les gens devrait être répartie 3 à 5 (selon les ratios de revenus). Il poursuit en calculant que si les ouvriers travaillaient un peu plus et mangeaient un peu moins, ils pourraient se permettre de payer l’impôt sur le revenu nécessaire pour remplir leur part de la charge fiscale.
Petty considérait sans ambiguïté qu’une population nombreuse était une bonne chose (« Fewness of people, is real poverty » (1662 )). La question politique naturelle est donc de savoir comment générer plus de travail. Contrairement à la dynamique malthusienne ou utilitariste, Petty ne croit pas que des salaires plus élevés conduisent à une plus grande offre de travail. Au contraire, il n’y voit qu’un effet de retour en arrière : « Les drapiers et d’autres personnes qui emploient un grand nombre de pauvres, lorsque le maïs est extrêmement abondant, ont observé que le travail des pauvres est proportionnellement cher, et qu’il est rare d’en trouver (tant ils sont licencieux et ne travaillent que pour manger ou plutôt pour boire) ». (Petty, 1676 ). Par conséquent, les salaires ne devraient pas être élevés, mais juste assez pour permettre aux travailleurs de « vivre, travailler et générer » (Petty, 1672 ).
Bien que Petty ait subi quelques pertes à travers la Cour des Innocents de 1662, sa propriété de vastes possessions en Irlande avait été largement confirmée à la Restauration. Mais la Cour des réclamations de 1666 rouvre la question, et Petty se sent obligé d’interrompre ses efforts scientifiques et courtois et de retourner à Dublin pour défendre ses revendications.
Petty revient à l’économie politique dans les années 1670, après avoir été sollicité par Edward Chamberlayne pour l’aider à rassembler des matériaux sur l’Irlande pour une nouvelle édition du livre de Chamberlayne, The Present State of England. Les efforts de Petty ont abouti à la composition de son propre traité, The Political Anatomy of Ireland (1672, publié en 1691), suivi d’un exercice similaire pour l’Angleterre, le célèbre Political Arithmetik (1676, publié en 1690). C’est dans la préface de ce dernier qu’il fait sa célèbre prise de position en faveur du raisonnement scientifique en économie :
La Méthode que je prends pour faire cela, n’est pas encore très habituelle ; car au lieu de n’employer que des Mots comparatifs et superlatifs, et des Arguments intellectuels, j’ai pris le parti (comme un Spécimen de l’Arithmetique politique que j’ai longtemps visé) de m’exprimer en termes de Nombre, de Poids, ou de Mesure ; de n’utiliser que des arguments de sens, et de ne considérer que les causes qui ont des fondements visibles dans la nature ; de laisser à la considération d’autrui celles qui dépendent des esprits, des opinions, des appétits et des passions changeants de certains hommes : (Petty, 1676 )
L’Arithmétique politique de Petty (1676) tente de comparer les revenus et les richesses de la France, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne. Calculant que la France a 13 fois plus de population et 80 fois plus de terres que les Pays-Bas, mais seulement 3 fois plus de revenus, Petty procède « pour montrer que cette différence d’amélioration de la richesse et de la force, découle de la situation, du commerce et de la politique des lieux respectivement ; et en particulier des commodités pour la navigation et le transport par eau. » (p.255). Petty passe en revue certains des avantages des Pays-Bas par rapport à la France, qui comprennent la géographie(en particulier les voies navigables), les caractéristiques nationales (éthique du travail, liberté de conscience), les droits de propriété (registres), la banque et les politiques mercantilistes de la République néerlandaise.
(Petty reprend l’exercice statistique de 1665 (Petty (1676 ) calculant le revenu britannique à 42£,16£ en loyers et profits,26£ en revenus du travail, la richesse matérielle à 320£ et la richesse de la population à 520£)
Petty s’est abstenu d’imprimer l’Arithmétique politique. Il a été diffusé en privé sous forme de manuscrit et, en 1683, publié anonymement sans son consentement sous un autre titre. Ce n’est qu’en 1690, après la Glorieuse Révolution et la mort de Petty lui-même, que sa famille jugea bon de le publier enfin avec son anatomie de l’Irlande. Les réticences de Petty étaient fondées sur les conséquences du livre en matière de politique étrangère. Les monarques Stuart, poussés par les mercantilistes, avaient adopté une position activement hostile à l’égard de l’agile république commerciale des Pays-Bas et, à cette fin, avaient cultivé une alliance avec la France. Mais Petty, qui n’a jamais été très impressionné par la richesse commerciale, diminue l’importance de la concurrence des Pays-Bas avec l’Angleterre. C’est la France, et ses vastes ressources réelles en terres et en hommes, que Petty craignait de considérer comme le véritable danger. Par conséquent, son Political Arithmetik regorge de notes alarmistes sur la « menace » française pour la Grande-Bretagne. Mais tant que les rois Stuart étaient alliés à la France (recevant même des subventions secrètes du monarque français), Petty pensait qu’il n’était pas sage de les embarrasser (et de récolter l’infamie de la cour pour lui-même) avec un tel tract gallophobe.
En 1685, Petty se retira sur ses terres en Irlande, et mourut deux ans plus tard. Apôtre de Hobbes, Petty était un mercantiliste dans ses politiques, mais on peut trouver des rudiments de la théorie du travail de la valeur et est donc souvent considéré comme un précurseur de l’École classique. Il a particulièrement influencé Davenant et Locke.